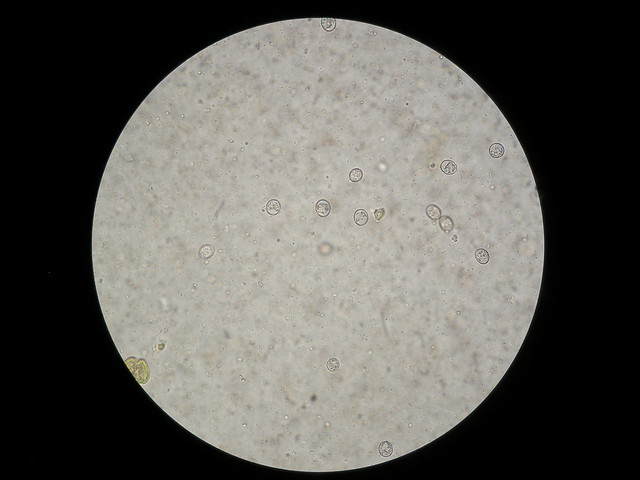J’ai mal au crâne. Un genre de coton autour des yeux. Probablement une petite insolation. Allongé dans mon lit, j’erre sur les réseaux sociaux. Nous sommes samedi, il est 22h, mon astreinte a démarré depuis 3 heures, à la fermeture de la clinique. Jusque là, tout va bien. A peine deux appels, gérés sans difficulté au téléphone. Aujourd’hui, je ne travaillais pas. Pas vraiment. J’étais d’astreinte la nuit précédente, comme les trois d’avant et les douze prochaines (les vacances des autres, c’est atroce). Hier, il y a bien eu cet appel lunaire vers 23h, d’un homme qui avait trouvé un chat « avec de drôles de convulsions, et qui hurle bizarrement, au milieu de la rue, mais ce n’est pas le mien, non, je ne peux pas vous l’amener il a l’air agressif, vous pourriez venir ? Nous sommes dans la rue qui monte ? »
Je m’étais donc lancé dans cette improbable expédition, armé d’une boîte à chats, d’une serviette éponge et d’une paire de gants en cuir. J’avais descendu à pied la rue qui monte, il y avait 4 ou 5 personnes qui riaient et discutaient fort dans la lumière des phares. Leur voiture barrait le bas de la rue. Un peu plus haut, dans le caniveau, il y avait le chat. Manifestement accidenté, du sang autour de lui, conscient, très algique, très stressé, peu agressif mais dangereux par peur, je lui avais posé la cage devant le nez, il s’était jeté dedans, couvert de merde et de sang, en me crachant dessus. Pour attraper un chat terrorisé, incapable de s’enfuir, l’astuce, c’est de lui offrir un refuge. J’avais fait forte impression sur ces voisins qui m’avaient appelé, en tout cas. Ils avaient bien une idée du propriétaire, mais il n’était pas là. On verrait le lendemain.
J’avais pris congé rapidement, j’étais rentré à la clinique, j’avais ouvert la boîte à chat dans une de nos cages. Le chat était tellement stressé que je pouvais le manipuler. Pas anesthésiable, mais de toute façon, il n’était pas temps de pousser le diagnostic. D’abord, gérer la douleur. J’avais réussi à placer toutes mes injections, il était tellement mort de trouille qu’il ne pensait pas à mes aiguilles lorsque je lui cachais la tête sous la serviette. J’avais tout noté sur une feuille scotchée à l’écran de l’ordinateur de l’accueil (fiche informatique 2019, modèle minuit). On verrait le lendemain.
Aujourd’hui, quoi.
Aujourd’hui, je ne travaillais pas. Enfin, juste en seconde ligne. Ma collègue gérait la clinique, en tout cas la canine, j’interviendrais seulement en cas d’urgence ou de visite sur des bovins ou équins. En cette saison, peu de risque. Certes, il y avait la chasse, mais j’espérais que la chaleur prévue la ferait cesser rapidement.
A 9h30, je restais seul à la maison avec mes enfants. A 9h45, je leur suggérais de s’habiller, au cas où on m’appellerait : il faudrait partir vite. A 10h, le téléphone sonnait : 5 chiens de chasse, et le planning standard déjà saturé. C’était pour moi !
J’arrivai en même temps que les chiens de chasse à la clinique. J’y abandonnai mes filles à leur sort, laissant un message à ma moitié pour qu’elle sache où les retrouver. Les adultes seraient trop occupés pour regarder : je ne savais quelles aventures elles sauraient inventer.
Le premier chien de chasse avait une plaie à la tête qui saignait beaucoup, et comme il s’était joyeusement ébroué en montant sur la table, il nous avait constellé de taches rouges, tout comme le sol, les murs et les meubles. Je n’ai pas vérifié le plafond. Il s’était ensuite débattu en entendant le bruit de la tondeuse, en rajoutant donc une couche, j’avais fini par abandonner et poser le cathéter au milieu des poils. Il fallu l’anesthésier pour que cesse la constellation hémorragique. Ma blouse et mon visage étaient couverts de taches de sang. Le chasseur aussi. Plusieurs fois au cours de la première heure de suture, j’ai vu mes princesses passer la tête par l’une des portes de la salle de chirurgie. Je les ai invitées à rester pour regarder si elles le souhaitaient, elles sont reparties sans mot dire. Il y a quelques années, l’aînée assistait à ces séances de couture, de pneumothorax, de ventres ouverts et de membres démontés dans les bras des chasseurs. Elle avait six mois. Aujourd’hui, elle ne reste pas. Mais je sais que tout à l’heure, elle me demandera : « est-ce que tu les as sauvés, ceux-là ? ».
Aujourd’hui, oui, je les ai sauvés. J’achevai le dernier point à midi, une bricole sous anesthésie locale. Les autres chiens s’étaient bien réveillés, tout le monde pouvait rentrer. Du spectaculaire, mais rien de grave. Par contre, mon assistante m’avait ajouté deux visites : deux vaches à voir chez une éleveuse, et un chien en fin de vie, pour une euthanasie à domicile. Pour 14h. Je lui demandai de les appeler, je préférai y aller maintenant. Comme ça, je serais tranquille pour gérer les prochaines urgences cet après-midi. Ou rester paisiblement chez moi.
A 12h15, je garais ma voiture chez Mme Estours, l’éleveuse. 32°C sur le thermomètre de la voiture, les chiens de chasses étaient forcément tous rentrés, je n’en aurai pas d’autre à réparer.
Je commençai par voir une vache qui se remettait mal d’une mammite. Transit en berne, rumination presque au point mort, rumen impacté. Une pompe à bras, un long tuyau, et j’envoyai 20 litres de flotte additionnée de sels et de 2 litres d’huile de paraffine dans sa panse, histoire de déboucher la plomberie. Tant qu’à y être, elle me montra une autre vache, une boiterie récente, elle espérait un panaris ou une autre bricole. Je pensai plutôt à une lésion haute. Un bras dans son rectum, je lui demandai de la faire marcher. Les craquements ressentis à l’intérieur de son bassin me confirmèrent mon hypothèse : fracture du pelvis. Du repos, un sol stable, pas d’autres vaches, et elle s’en remettrait sans doute assez bien. Juste assez pour être dans les dernières à partir, car au fil de la visite, l’éleveuse me confirma ce qu’elle annonçait depuis longtemps : sa cessation d’activité prochaine. Ses fils ne reprendraient pas de bétail. Une ferme de moins. Une de plus. Cela fait des années qu’à chaque visite, elle m’explique la dernière crasse administrative inventée. Les conditionnalités des primes, les documents, les délais, les petites lignes. Le prix du lait. « A 67 ans, vous croyez vraiment que je suis capable de les gérer, leurs entourloupes ? S’ils veulent nous faire crever, qu’ils nous le disent au lieu de faire semblant ! »
Mes nuits vont continuer à s’apaiser, mais me restera-t-il encore longtemps des vêlages à raconter ?
A 13h15, j’étais assis à une table de jardin sous un saule pleureur. Je caressais une vieille saucisse qui ne savait pas trop si elle devait m’aboyer dessus, m’ignorer, vivre, mourir ou aller manger. La vieillerie incarnée, avec un cancer inopérable. Ce matin, elle avait fait une longue et épuisante crise de toux, ils s’étaient décidé : c’était terminé. Son indignation en constatant que j’osais débarquer chez elle au lieu de rester enfermé dans la clinique où ses maîtres s’obstinaient à l’amener régulièrement les avaient fait douter.
J’avais écouté l’avis de chacun : les grands-parents, les enfants, les petits enfants. J’avais questionné, assis en rond sous le saule, au bord du canal du moulin, à une table de jardin autant de guingois que la vieille bicoque et leur chien. Nous avions conféré. La conclusion, finalement, serait que la mort pouvait bien attendre, ce que la vieille chienne avait confirmé en allant vider sa gamelle d’une démarche incertaine.
A 14h00, j’étais chez moi, j’avais mangé. On ne me rappelait pas. J’allais donc pouvoir me consacrer à massacrer des ronciers à la débroussailleuse pour excaver les clôtures qui se dissimulaient, je le savais, quelque part en dessous. Pour faire tomber les ronces qui partaient à l’assaut des noyers, accompagnées de lianes indéterminées. A 17h00, trempé de sueur, j’achevais le dernier roncier. Ma femme me tendit le téléphone et 1/2 litre d’eau : « un vêlage chez M. Garbet. »
Un vêlage chez M. Garbet, ce serait probablement une césarienne. L’ambiance serait différente de chez Mme Estours à midi. Ici : 200 vaches, autant de vêlages, de grands bâtiments, et des gens très déterminés. Je me garais devant l’une des trois stabulations, la plus petite, celle des « tantes », les vaches laitières utilisées pour faire téter les veaux de lait. Entre les barrières, une montbéliarde. Autour des barrières, le patriarche, sa belle-fille, sa petite-fille.
Je su que j’allais suer. J’enfilai ma combinaison en plastique, mes gants. Une exploration vaginale : une torsion utérine, col fermé, irréductible. Césarienne inévitable. Tous soupirèrent, puis le ballet commença : deux seaux, de la paille propre, la cordelette pour attacher la queue de la vache à son jarret, histoire d’éviter qu’elle colle son toupillon plein de merde dans la plaie chirurgicale, la corde entre les jarrets, pour limiter les coups de pied. J’injectai des tocolytiques pour faciliter la manipulation de l’utérus : première mauvaise surprise, la vache me bondit dans les bras. Une pince mouchette plus tard, je lui rasai le flanc, puis le désinfectai. Lorsque mon aiguille toucha sa peau pour l’anesthésie locale, elle rua à nouveau dans les brancards. Il allait falloir la sédater. Pour elle, et pour nous.
La césarienne à proprement parlé se déroula sans réelle difficulté. Anesthésier le cuir et le muscle, inciser, écouter mon téléphone sonner, repousser les intestins à leur place, réduire la torsion utérine, repousser les intestins à leur place, inciser l’utérus, écouter mon téléphone sonner, repousser les intestins à leur place, extraire le veau, le réanimer, sortir l’utérus du ventre, écouter mon téléphone sonner, recoudre l’utérus, le remettre à sa place, suturer le premier plan musculaire, écouter mon téléphone sonner, regarder la vache tomber au sol, l’insulter, écouter mon téléphone sonner, détacher les cordes, se dire qu’évidemment, il fallait que comme les tartines, elle tombe côté confiture (mais heureusement le plan musculaire profond était suturé…), puis l’aider à se relever, écouter mon téléphone sonner, nettoyer et désinfecter la plaie pleine de fumier, faire la deuxième suture musculaire, puis la cutanée, écouter mon téléphone sonner, injecter antibiotiques et anti-inflammatoires, vérifier le veau un peu sonné et puis, prendre congé. Après avoir enlever mon t-shirt totalement détrempé, façon sortie de machine à laver sans essorage.
Ah : et écouter les 5 messages sur mon répondeur. Passant de « AAAAAAH c’est affreux » à « AAAAAH mais pourquoi vous ne répondez pas ?» puis à « Bon ben je pars ailleurs ». Rappeler ceux dont je ne savais pas s’ils avaient trouvé un confrère ou une consœur, et puis, une fois avoir tout géré, rentrer à la maison.
Il était alors 19h et quelques, l’heure de terminer cette journée de repos et de débuter l’astreinte. Après avoir lancé une machine à laver.
jeudi 29 août 2019
Un jour de repos
jeudi 29 août 2019, 13:25 / 9 commentaires