J’écris ceci le 23 juin 2020. Trois mois ont passé depuis le début du confinement du pays, un et demi depuis sa fin. La pandémie continue de s’étendre et nous ne pouvons toujours pas imaginer son impact sur nos sociétés.
A notre tout petit niveau, tout semble passer si vite ! Qui se souvient encore de l’élan de solidarité des professionnels de santé face au cafouillage des masques ? De la réactivité de l’Ordre ? Du chômage partiel, de l’incertitude ? Qui se rappelle qu’il y a quelques semaines seulement nous nous demandions quelle case faire cocher sur un papier pour que nos clients puissent nous amener leurs animaux ?
Je suis déjà passé à autre chose. A une espèce de course d’endurance à l’étouffée, un masque sur le visage, un distributeur de solution hydro-alcoolique sous la main. Cela fait déjà plus de trois mois que la porte de notre clinique est fermée et que nos ASV courent l’ouvrir à chaque fois qu’on sonne. Nous nous habituons et les interrogations d’hier semblent dérisoires, vues d’aujourd’hui. Elles étaient invraisemblables, avant. Nous n’avons aucune idée des questions qui se poseront demain. Le monde improvise, et nous avec.
Finalement, l’importante charge de travail dans ma clinique me permet de recoller au quotidien. Au risque de m’y noyer et de perdre le reste de vue. Mais je ne peux pas me permettre d’être étourdi par les chiffres de la pandémie, par la situation politique en France ou aux Etats-Unis ou par la disparition du permafrost alors que les consultations se succèdent à un rythme frénétique et que je dois jongler entre un chat diabétique, un lapereau à vacciner et un cheval à l’œsophage bouché. On a besoin de moi ici et maintenant. A la clinique, et à la maison.
Ici, et maintenant. Mais où seront ici et maintenant, dans quelques mois ?
Quelles seront mes solutions pour ne pas perdre pied ? Et les vôtres ? Celles de ma profession, celles de l’univers que je peux appréhender, sur lequel je peux agir ?
J’ai besoin de piliers sur lesquels m’appuyer. Nous en avons tous besoin.
J’ai besoin de la science, qui fonde ma pratique professionnelle. Qui est là pour m’expliquer le monde dans lequel je vis et doit me permettre de dépasser mes biais et mes croyances.
J’ai besoin des relations humaines qui fondent mon exercice quotidien. Je ne suis pas vétérinaire pour soigner les animaux, mais pour soigner des animaux qui vivent avec des humains. L’animal de compagnie comme de rente se définissent par leur lien à l’humanité. C’est dans cet espace, dans le regard et les mots du « maître », que je touche l’humain et que l’humain me touche.
J’ai besoin d’avoir les pieds dans la bouse et la tête dans les défis sanitaires et éthiques de l’élevage pour redevenir concret et utile à la société.
J’ai besoin, enfin, du regard confiant d’un chien, d’un chat sur mes genoux, du souffle d’un cheval dans mon cou, d’un veau qui m’asperge de liquide amniotique. Parce que mon monde n’est pas qu’humain, parce que c’est là que se trouve et se trouvera toujours mon ici et maintenant.
Ce billet a été écrit pour La Semaine Vétérinaire numéro 1862 du 3 juillet 2020
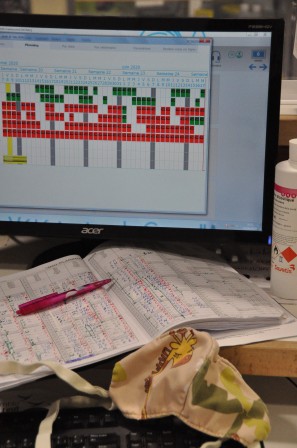 A chaque semaine qui passe, tout semble vouloir nous ramener vers la « normale ». Pourtant, les masques, les distributeurs de SHA et les gestes barrière persistent. Pourtant, malgré nos envies de regarder ailleurs, les nouvelles alarmantes continuent d’affluer. Ici, la deuxième vague menace, tandis qu’ailleurs, la première n’en finit pas de submerger les pays les plus pauvres ou les plus riches.
A chaque semaine qui passe, tout semble vouloir nous ramener vers la « normale ». Pourtant, les masques, les distributeurs de SHA et les gestes barrière persistent. Pourtant, malgré nos envies de regarder ailleurs, les nouvelles alarmantes continuent d’affluer. Ici, la deuxième vague menace, tandis qu’ailleurs, la première n’en finit pas de submerger les pays les plus pauvres ou les plus riches. Certains ont annoncé, dès les premières rodomontades du Pr Raoult, que la science serait la grande perdante de cette épidémie de COVID-19. Je ne sais qu’en penser. Je crois qu’on peut faire une longue liste des grands et petits perdants de cette épidémie. En ce qui concerne la science…
Certains ont annoncé, dès les premières rodomontades du Pr Raoult, que la science serait la grande perdante de cette épidémie de COVID-19. Je ne sais qu’en penser. Je crois qu’on peut faire une longue liste des grands et petits perdants de cette épidémie. En ce qui concerne la science…